Avant que les ombres s’effacent
Louis-Philippe Dalembert
Sabine Wespieser Editeur (2017)
(Par Annie Forest-Abou Mansour)
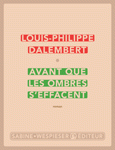 Dans Avant que les ombres s’effacent, Louis-Philippe Dalembert (1) plonge le lecteur dans une fiction fondée sur le réel, le vécu, l’Histoire située entre Berlin, Paris et Port-au-Prince des années trente à 2014. Il relate en s’appuyant sur une solide et riche documentation historique les persécutions nazies subies par les Juifs d’Europe, l’existence du docteur Ruben Schwarzberg et de sa famille tout en immergeant le lecteur dans la petite île accueillante, lumineuse et chaleureuse d’Haïti.
Dans Avant que les ombres s’effacent, Louis-Philippe Dalembert (1) plonge le lecteur dans une fiction fondée sur le réel, le vécu, l’Histoire située entre Berlin, Paris et Port-au-Prince des années trente à 2014. Il relate en s’appuyant sur une solide et riche documentation historique les persécutions nazies subies par les Juifs d’Europe, l’existence du docteur Ruben Schwarzberg et de sa famille tout en immergeant le lecteur dans la petite île accueillante, lumineuse et chaleureuse d’Haïti.
Dans une narration non linéaire, le lecteur découvre le réel à travers le regard, les pensées, les paroles, les émotions du docteur Ruben Schwarzberg, un exilé, un déraciné. Dans ce roman trajectoire, Ruben traverse différents pays : né en Pologne en 1913, il passe sa jeunesse à Berlin. Mais la tragique nuit de cristal de novembre 1938 le confronte à la haine et à la violence : des « types se lancèrent dans leur direction en braillant des insultes, le visage défiguré de haine ». Il ne doit son salut qu’à la rencontre opportune de personnes « appartenant à la légation d’Haïti » qui le font monter in extremis dans leur voiture. La haine antisémite accule Ruben et sa famille à l’exil. Le jeune homme connaît alors le camp de concentration de Buchenwald, un centre de rétention parisien, l’errance sur le paquebot Le Saint Louis. En effet, Cuba, les Etats Unis refusent d’accueillir les réfugiés sous prétexte que des espions nazis pourraient se cacher parmi eux !
Mais Ruben s’ouvre aussi à la vie culturelle magique des artistes de Paris. Il fréquente la belle et élégante poétesse haïtienne Ida Faubert, « le premier secrétaire de la légation d’Haïti, une jeune poète plein d’avenir du nom de Roussan Camille ». Il rencontre Stéphane Grappelli, Django Reinhardt, Maurice Thibault…, vit une merveilleuse histoire d’amour avec l’épouse d’un ambassadeur, la sublime Marie-Carmel Gutierrez qui « savait jouer de son corps comme d’un instrument de musique, en tirer les notes les plus vibrantes, des accords dont Ruben lui-même ignorait que ses sens étaient porteurs ». Enfin grâce à ses amis caribéens et un décret-loi voté par l’Etat haïtien autorisant les citoyens Juifs à obtenir un passeport puis la nationalité haïtienne une nouvelle vie s’offre à lui dans la Perle des Antilles.
Jamais Ruben ne raconte à sa famille, hormis à son oncle Joshua avec qui il a été interné à Buchenwald, les événements tragiques qu’il a vécus. Ce n’est que lors du séisme de janvier 2010, alors « qu’il pensait avoir laissé toute cette histoire derrière lui » qu’il se confie à sa nièce Déborah, la petite fille de sa tante, la belle Ruth partie s’installer en Palestine pour la fondation d’un Etat lors de la montée du nazisme en Allemagne dans les années 1939. Déborah, que Ruben n’a encore jamais rencontrée, fait partie « des médecins israéliens qui, à peine les premières images diffusées sur Internet et à la télévision, s’étaient portés volontaires pour venir dans l’île ». La jeune femme venue secourir, soigner, aider des rescapés du tremblement de terre, veut connaître son oncle dont sa grand-mère lui a tant vanté les mérites et les compétences. Alors qu’il ne pouvait raconter l’indicible, l’innommable, il remonte le cours de son existence et relate ce qui a été tu, si ce n’est refoulé pendant des années à celle qui « avec ses boucles de feu (…) était le portrait craché de sa grand-mère ». C’est « comme si » Ruth « venait lui apporter un message important du royaume des morts ». La sublime Ruth, « la pasionaria d’une grande éloquence », leur métier commun, leur amour pour leur prochain unissent Déborah et le docteur Schwarzberg. Une complicité naît donc rapidement entre le vieil homme et la jeune femme. La nièce est le prétexte à raconter. Ruben avant de plonger dans le monde des ombres (« avant que les ombres s’effacent, qu’il ne redevienne poussière, ou néant ») raconte et se raconte.
Avant que les ombres s’effacent englobe tout un petit monde : une famille, des amis, une communauté persécutée. Cet ouvrage invite le lecteur à revisiter l’Histoire, à connaître des épisodes encore peu connus de la Seconde Guerre mondiale : le courage de la « république indépendante, libre et démocratique d’Haïti (qui) déclar( e ) les hostilités au IIIe Reich et au Royaume d’Italie », vote un décret-loi permettant à tout Juif de bénéficier de la naturalisation haïtienne et surtout évacue la notion aberrante et absurde de « race ». L’ouvrage De l’égalité des races humaines d’Anténor Firmin circule au fil des pages de l’ouvrage de Louis-Philippe Dalembert. Il accompagne Ruben dans tous les moments de sa vie, – enfant, il apprend à lire dans cet ouvrage -, dans tous ses déplacements de Berlin, à Buchenwald, à Paris, à Haïti, jouant un rôle important dans son existence puisqu’il est à l’origine de son prénom. Salomé, sa sœur aînée s’inspire en effet pour choisir le prénom de son frère cadet de l’ouvrage « écrit par le médecin et intellectuel Haïtien Anténor Firmin ». Cet essai décisif prouve, si c’est nécessaire, que le mot « races » est une aberration. En effet, il n’existe qu’une seule race sur terre, celle de l’homo sapiens sapiens. Le docteur Schwarzberg n’est-il pas polonais, berlinois, parisien avant de devenir un haïtien assimilé ? « Les êtres humains (sont) tous des nègres (…) des nègres noirs, des nègres blancs, des nègres bleus, des nègres cannelle, des nègres rouges, sous la peau ou tout court, des nègres jaunes, des nègres chinois aux yeux déchirés (…) » écrit Louis-Philippe Dalembert avec un clin d’œil complice et rempli d’humour à Aimé Césaire et à ses écrits sur la notion de négritude et sur la fierté d’être noir. A Haïti, cette osmose entre les êtres humains existe comme en témoigne la sublime métaphore du docteur Schwarzberg : « Ici, tout le monde vient d’ailleurs (…) Les racines des uns se sont entremêlées à celles des autres pour devenir un seul et même tronc ». Les individus comparés à des éléments végétaux aux racines solidement enfoncées dans la même terre se mélangent, s’unissent, s’imbriquent pour donner naissance à l’Humain.
Au détour d’une phrase, d’un dialogue, d’une description, Haïti l’île à la culture plurielle – et ses arcanes – se dévoile, splendide, ouverte, sensuelle, sympathique et généreuse. L’exotisme, la couleur locale n’intéressent pas le narrateur. Il veut avant tout plonger le lecteur dans l’intime du pays, dans la compréhension de l’Autre. En même temps, le passé et le présent se tricotent subtilement. Les situations actuelles stimulent l’écriture truffée d’allusions satiriques et compatissantes de l’écrivain. Implicitement derrière le passé sourd le présent. La souffrance, la haine subie par des humains humiliés, maltraités par l’Histoire concernent le passé et le présent. Pendant la Seconde Guerre mondiale des demandeurs d’asile, des réfugiés jugés encombrants errent, (« Les Etats-Unis avaient instauré un système strict de quota annuel, qui faisait peu cas des dangers que les gens couraient ici ; ils voulaient s’assurer, se justifiaient-ils, que le régime nazi n’avait pas glissé des espions de l’Abwehr, le service de renseignements de l’armée, parmi les immigrants ») rejetés, se heurtant à l’incompréhension, à l’égoïsme, à l’indifférence. En 2017, le Liban, minuscule pays de quatre millions d’habitants, a accueilli environ un million et demi de Syriens. Comme Haïti, c’est un petit pays qui offre l’hospitalité à des réfugiés. La générosité, la solidarité se trouvent toujours chez les plus humbles et les plus faibles. Pareillement, le discours des pouvoirs totalitaires et des extrémistes retourne, falsifie la vérité et dupe par la peur en faveur de leur idéologie : « loin de condamner les exactions (contre la communauté juive) la dépêche y voyait des émeutes spontanées en représailles, selon le pouvoir, au tapage nocturne et aux provocations d’une catégorie bien spécifique de la population ». La haine remplace la bienveillance et la compréhension. La mort l’emporte sur la vie. De grands et riches pays arrogants jugent, donnent des leçons comme la France et les Etats-Unis, les « deux nations les plus arrogantes de la planète ». Des êtres masquent leurs lacunes, leur ignorance en méprisant l’altérité, en jouant les cadors : « Et les Parisiens, c’est connu, sont peu patients avec ceux qui mastiquent mal leur langue, une manière habile, au fond, pour cacher leurs propres lacunes dans celle des autres ». Des sociétés sombrent dans la déliquescence à cause de leur orgueil, de leur manque d’humanité, de leur peur de l’Autre et de la différence, incapables de comprendre que différence ne signifie pas opposition.
Dans ce récit dans le récit où le style indirect libre domine, où le parler locale se tisse avec la langue littéraire esthétique et recherchée, Ruben raconte des faits terribles sans tomber dans le pathos. Les moments de tension, les moments forts sont cassés avec des effets d’humour et d’ironie comme lorsque Ruben est arrêté par de stupides et prétentieux policiers français qui confondent Haïti et Tahiti. Le narrateur reste sur la ligne de crête. Derrière le regard de Ruben se trouve l’auteur. Les effets d’humour (« Il n’y avait pas de quoi fouetter un chat nippon », « une maîtresse hors pair, pas seulement pour l’enseignement de la langue ») d’ironie viennent de cette double perception comme dans les descriptions du « guignol gesticulant de Herr Hitler » ou de l’Allemagne : « Aux yeux du peuple qui s’y connaissait, ce n’était pas du caca de coq gaulois, l’Allemagne. C’était le symbole de puissance absolue. Tenez, les maringouins de la ville des Gonaïves, les moustiques les plus costauds de toute l’Amérique, qu’aucune aspersion massive d’insecticide n’a jamais su éradiquer (…) ». Avant que les ombres s’effacent possède un style rythmé, très imagé où le visuel, l’auditif, l’olfactif se mêlent emportant souvent le lecteur dans un univers poétique. Louis-Philippe Dalembert renouvelle les clichés : « c’était blanc bicorne, bicorne blanc », joue avec une écriture faite de virtuosité dans une œuvre à la structure moderne avec ses allers retours entre le passé et le présent. Le sourire, la solidarité, celle des voisins de la famille Schwarzberg ou celle régnant dans le camp s’impose, le positif jaillissant du négatif : « Au-delà de l’horreur, ce qui le marquerait le plus, ce fut d’avoir trouvé, au moment où il s’y attendait le moins une parcelle d’humanité dans ce lieu, comme un bourgeon en fleur au mitan d’un champ de bataille. Un clin d’œil de la vie, là où des hommes donnaient avec jubilation la mort à d’autres hommes ». L’espoir domine toujours chez Louis-Philippe Dalembert, concrétisé par le retour en boucle du chapitre final où le hasard une fois de plus intervient de façon positive, permettant aux descendants du docteur Schwarzberg et de « Johnny l’Américain » de se retrouver. La reconnaissance et la mémoire vivante continuent à fleurir dans les jeunes générations. Le passé est toujours omniprésent.
Il y aurait encore tellement à dire à propos du très beau livre, Avant que les ombres s’effacent de Louis-Philippe Dalembert qui s’inscrit dans la fiction biographique, le récit de filiation, le roman historique, qu’on ne peut qu’en conseiller vivement la lecture.
- Louis-Philippe Dalembert est un écrivain, un poète, un essayiste, un « professeur invité dans des universités américaines et suisses, écrivain en résidence à Rome, Jérusalem ou Berlin ».
Il a écrit entre autres :
Noires blessures
Histoire d’amour impossibles… ou presque.
Rue du faubourg Saint-Denis
http://lecritoiredesmuses.hautetfort.com/archive/2005/11/22/quand-l-humour-l-emporte.html
Les dieux voyagent souvent la nuit.
http://lecritoiredesmuses.hautetfort.com/archive/2011/01/07/les-dieux-voyagent-la-nuit.html
L’Ile du bout des rêves.
http://lecritoiredesmuses.hautetfort.com/archive/2007/10/03/l-ile-du-bout-des-reves.html

0 commentaires